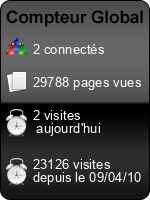Le paradoxe de l'immigration
Bien accueillis, les nouveaux venus sont rapidement laissés à eux-mêmes
Lisa-Marie Gervais 10 avril 2010

Photo : Agence Reuters Larry Downing
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/286708/le-paradoxe-de-l-immigrationLe marché du travail est un obstacle de taille à l’intégration.
Le Québec peine à intégrer ses immigrants, révélait cette semaine une étude commandée par le CIRANO. Pis, il est en queue de peloton lorsque comparé à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, deux provinces où le taux d'immigration est élevé. Simple question de discrimination? Il semblerait que le problème soit plus complexe.
Les Québécois vieillissent, prennent leur retraite. Devant cette désertion du marché du travail, le Québec est forcé de s'en remettre à sa main-d'oeuvre immigrante, qui représentait en 2006 11 % de la population totale. Il n'est d'ailleurs pas de question qui fasse davantage consensus, tant dans les partis politiques que dans les syndicats et autres groupes de pression.
Non seulement la Belle Province intègre-t-elle très mal ses immigrants, mais elle le fait également beaucoup moins bien que dans le reste du Canada, révèle une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) intitulée Immigration au Québec: politiques et intégration au marché du travail. En 2006, le taux d'emploi des immigrants au Québec était inférieur de 11,4 points à celui des Québécois nés ici, soit un écart deux fois plus grand que celui observé dans les deux autres provinces, l'Ontario (5 points) et la Colombie-Britannique (5,1 points).
Le Québec a ouvert ses portes, et les immigrants arrivent, nombreux. La grille de sélection pour attirer une main-d'oeuvre qualifiée et qui parle français fonctionne, rappelle Maude Boulet, doctorante en relations industrielles à l'Université de Montréal et coauteure, avec Brahim Boudarbat, de l'étude publiée cette semaine. Les immigrants sont de plus en plus qualifiés — la proportion des immigrants récents du Québec (âgés de 25 ans et plus) qui détiennent au moins un baccalauréat est passée de 15,4 % en 1981 à 51 % en 2006 — et ils sont beaucoup plus nombreux à parler le français à l'arrivée (60,4 % des immigrants admis au Québec en 2008 parlaient le français).
Beau paradoxe, reconnaissent les observateurs de la scène immigrante. «On favorise l'immigration des personnes ayant des diplômes supérieurs, on leur donne des cours de français si elles ne le connaissent pas déjà, mais après ça, on ne les aide plus», dit la professeure en relations industrielles à l'UdeM Marie-Thérèse Chicha, qui déplore le sous-financement de l'intégration. «Les politiques d'immigration ne sont pas cohérentes avec les politiques d'intégration. C'est du gaspillage de compétences.»
Afin de hausser le taux d'emploi des nouveaux arrivants, le député péquiste de LaPrairie, François Rebello, souhaite que les dirigeants fassent preuve de plus de transparence et rendent des comptes. «Il faut être intransigeants à l'égard de ceux qui discriminent, insiste M. Rebello. Et c'est au gouvernement de donner l'exemple.»
Le sociologue de l'UQAM Jean Renaud abonde dans ce sens: le gouvernement, comme premier employeur, devrait servir de modèle. «Il y aurait moyen d'accélérer leur embauche. Il y a des milliers de solutions, des choses qui se font déjà ailleurs. Mais lesquelles sont applicables? On peut penser au mentorat», indique M. Renaud. Mais avant de parler solutions, voyons un peu la genèse du problème de l'intégration des immigrants, qui touche dans une plus forte proportion les immigrants originaires de l'Afrique du Nord (Maghreb) et du Moyen-Orient.
Racistes, les employeurs ?
Pour Marie-Thérèse Chicha, la lente intégration des immigrants sur le marché du travail pourrait s'expliquer en partie par des pratiques discriminatoires des employeurs. «Ils sont très réticents à embaucher des immigrants. Ils ont peur que ceux-ci se mettent à demander des congés. Cette idée que les immigrants vont chercher à demander des accommodements est très répandue, souligne-t-elle. Mais il y a aussi des employeurs de bonne volonté qui n'engagent pas d'immigrants de peur d'être accusés de discrimination s'ils licencient quelqu'un strictement pour une question d'incompétence. Mais c'est un mythe, il n'y a pas d'immigrants qui font ça», a-t-elle dit.
Reconnaissant que ce n'est pas le cas de tous les employeurs, Jean Renaud remarque qu'il y a une réelle discrimination à l'embauche, «qui se voit sur le terrain». On n'a qu'à penser à ces histoires qui défraient à l'occasion les manchettes d'immigrants qui ont soumis le même curriculum vitae à une entreprise, l'un avec un nom à consonance québécoise et l'autre avec un nom, disons, plus «exotique». Le CV de «M. Tremblay» est bien sûr privilégié, dans la grande majorité des cas.
N'empêche, selon le sociologue, cette attitude s'estompe après un certain temps. Au fil de ses recherches quantitatives et qualitatives, ce spécialiste des questions d'immigration a remarqué que le «coefficient Maghreb», c'est-à-dire l'ensemble des facteurs associés à l'origine d'une personne originaire de l'Afrique du Nord et pouvant nuire à son intégration, se fait sentir au début de l'établissement. «Mais après trois ans, les études montrent que ce n'est plus significatif. Si c'était de la discrimination, ce coefficient serait toujours significatif. L'employeur s'adapte et apprend à décoder ce que vaut un diplôme du Maghreb», a-t-il expliqué.
Et si le Québec fait moins bien que l'Ontario et la Colombie-Britannique, c'est qu'il n'est pas aussi habitué qu'eux à accueillir des immigrants, estime Jean Renaud. «Le Québec n'a que 30 ans de pratique avec l'immigration. Ça date de la loi 101. Avant ça, l'immigration était plutôt gérée par le côté anglophone du Québec, a-t-il soutenu. Mais on est encore en train de se chicaner sur le foulard. C'est comme si on confirmait le fait que c'est normal de discriminer. L'employeur envoie le message que ce ne sont pas des gens comme nous, qu'ils sont marginaux. Ça n'aide pas à rehausser le taux d'emploi.»
Professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Sylvie Gravel ne croit pas qu'il est exact de parler de discrimination de la part des employeurs. «Les grandes entreprises ont fait beaucoup d'effort pour redresser la situation et éliminer toutes les étapes qui portent préjudice aux immigrants», assure-t-elle. Elle remarque qu'un grand nombre de petites entreprises ont recours à des immigrants. Certains employeurs du secteur agricole vont même se mettre à parler espagnol pour mieux communiquer avec leurs employés latino-américains. «Le vrai problème, c'est d'intégrer les immigrants dans un emploi qui correspond à leur diplôme. On est en pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs pour lesquels on n'a pas nécessairement sollicité des immigrants», rappelle Mme Gravel, en précisant que c'est en train de changer.
La faute de la grille... et de la langue
La grille n'est donc pas si adéquate que ça. Jean Renaud, qui s'est intéressé aux variables permettant d'améliorer les prédictions d'accès à l'emploi pour un nouvel arrivant, a constaté que la grille de sélection ne comptait que pour 13 % dans ce savant calcul. «On a essayé de voir combien de temps ça prend à un immigrant pour avoir un emploi qualifié et quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer ça. La grille ne compte pas pour beaucoup», note-t-il. Selon lui, cette grille utilisée par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles n'est pas nécessairement conçue pour d'abord sélectionner de bons ouvriers appariés aux emplois disponibles. «Elle a avant tout comme but de nous choisir des concitoyens, des gens avec qui on va vivre. Des concitoyens qui deviendront nos amis, nos voisins, des gens qui vont tomber amoureux avec nos enfants.»
Certes, des problèmes plus structurels liés aux blocages que peuvent engendrer certains ordres professionnels dans le cas des professions règlementées sont désormais connus. L'attention a été moins portée sur les problèmes d'intégration sur le marché du travail causés par l'obligation, dans certains cas, de parler le français et l'anglais. «Il existe des exigences de bilinguisme pour un certain niveau d'emploi», note François Rebello. «Le fait de ne pas parler anglais est souvent un frein plus grand à l'emploi que le fait de ne pas parler français», ajoute-t-il, constatant que cette réalité bien québécoise nuit à certains membres de la communauté maghrébine, par exemple, qui connaissent souvent mieux le français que l'anglais.
Les études de Jean Renaud ne lui ont pourtant pas permis de conclure que le facteur de la langue était significatif. «La connaissance de l'anglais et du français n'est pas un facteur qui augmente l'accès au marché du travail. C'est plutôt une question de réseau au sens très large.»
Marie-Thérèse Chicha abonde. «Il ressort que la majorité des entreprises québécoises ont recours aux réseaux de connaissances pour leur recrutement. Et même quand ils sont diplômés du Québec, [les immigrants] n'arrivent pas nécessairement à se créer un réseau de connaissances susceptible de les aider à trouver un emploi. Ils n'ont pas un bon réseau culturel pour les informer informellement. Souvent, leur réseau est constitué de gens d'Emploi Québec ou des universités, qui ne les orientent pas nécessairement vers des emplois qui sont porteurs», fait-elle remarquer.
Pour sa part, Sylvie Gravel insiste sur l'importance de laisser le temps aux immigrants de bien apprivoiser leur milieu de travail. «Il faut comprendre la difficulté [pour les immigrants] de passer l'étape de la probation. On va reprocher à des gens de ne pas bien fonctionner dans le milieu, de ne pas être sociables parce qu'ils ne vont pas prendre une bière après le travail ou parce qu'ils ne jouent pas aux hockey avec les employés. Mais on oublie qu'il y a un élément qui s'appelle s'insérer dans une culture organisationnelle et une dynamique de socialisation», conclut-elle en appelant à plus d'indulgence.
Comme quoi il ne suffit pas d'avoir la tête de l'emploi. Encore faut-il s'assurer de la viabilité du «vivre ensemble».
Les Québécois vieillissent, prennent leur retraite. Devant cette désertion du marché du travail, le Québec est forcé de s'en remettre à sa main-d'oeuvre immigrante, qui représentait en 2006 11 % de la population totale. Il n'est d'ailleurs pas de question qui fasse davantage consensus, tant dans les partis politiques que dans les syndicats et autres groupes de pression.
Non seulement la Belle Province intègre-t-elle très mal ses immigrants, mais elle le fait également beaucoup moins bien que dans le reste du Canada, révèle une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) intitulée Immigration au Québec: politiques et intégration au marché du travail. En 2006, le taux d'emploi des immigrants au Québec était inférieur de 11,4 points à celui des Québécois nés ici, soit un écart deux fois plus grand que celui observé dans les deux autres provinces, l'Ontario (5 points) et la Colombie-Britannique (5,1 points).
Le Québec a ouvert ses portes, et les immigrants arrivent, nombreux. La grille de sélection pour attirer une main-d'oeuvre qualifiée et qui parle français fonctionne, rappelle Maude Boulet, doctorante en relations industrielles à l'Université de Montréal et coauteure, avec Brahim Boudarbat, de l'étude publiée cette semaine. Les immigrants sont de plus en plus qualifiés — la proportion des immigrants récents du Québec (âgés de 25 ans et plus) qui détiennent au moins un baccalauréat est passée de 15,4 % en 1981 à 51 % en 2006 — et ils sont beaucoup plus nombreux à parler le français à l'arrivée (60,4 % des immigrants admis au Québec en 2008 parlaient le français).
Beau paradoxe, reconnaissent les observateurs de la scène immigrante. «On favorise l'immigration des personnes ayant des diplômes supérieurs, on leur donne des cours de français si elles ne le connaissent pas déjà, mais après ça, on ne les aide plus», dit la professeure en relations industrielles à l'UdeM Marie-Thérèse Chicha, qui déplore le sous-financement de l'intégration. «Les politiques d'immigration ne sont pas cohérentes avec les politiques d'intégration. C'est du gaspillage de compétences.»
Afin de hausser le taux d'emploi des nouveaux arrivants, le député péquiste de LaPrairie, François Rebello, souhaite que les dirigeants fassent preuve de plus de transparence et rendent des comptes. «Il faut être intransigeants à l'égard de ceux qui discriminent, insiste M. Rebello. Et c'est au gouvernement de donner l'exemple.»
Le sociologue de l'UQAM Jean Renaud abonde dans ce sens: le gouvernement, comme premier employeur, devrait servir de modèle. «Il y aurait moyen d'accélérer leur embauche. Il y a des milliers de solutions, des choses qui se font déjà ailleurs. Mais lesquelles sont applicables? On peut penser au mentorat», indique M. Renaud. Mais avant de parler solutions, voyons un peu la genèse du problème de l'intégration des immigrants, qui touche dans une plus forte proportion les immigrants originaires de l'Afrique du Nord (Maghreb) et du Moyen-Orient.
Racistes, les employeurs ?
Pour Marie-Thérèse Chicha, la lente intégration des immigrants sur le marché du travail pourrait s'expliquer en partie par des pratiques discriminatoires des employeurs. «Ils sont très réticents à embaucher des immigrants. Ils ont peur que ceux-ci se mettent à demander des congés. Cette idée que les immigrants vont chercher à demander des accommodements est très répandue, souligne-t-elle. Mais il y a aussi des employeurs de bonne volonté qui n'engagent pas d'immigrants de peur d'être accusés de discrimination s'ils licencient quelqu'un strictement pour une question d'incompétence. Mais c'est un mythe, il n'y a pas d'immigrants qui font ça», a-t-elle dit.
Reconnaissant que ce n'est pas le cas de tous les employeurs, Jean Renaud remarque qu'il y a une réelle discrimination à l'embauche, «qui se voit sur le terrain». On n'a qu'à penser à ces histoires qui défraient à l'occasion les manchettes d'immigrants qui ont soumis le même curriculum vitae à une entreprise, l'un avec un nom à consonance québécoise et l'autre avec un nom, disons, plus «exotique». Le CV de «M. Tremblay» est bien sûr privilégié, dans la grande majorité des cas.
N'empêche, selon le sociologue, cette attitude s'estompe après un certain temps. Au fil de ses recherches quantitatives et qualitatives, ce spécialiste des questions d'immigration a remarqué que le «coefficient Maghreb», c'est-à-dire l'ensemble des facteurs associés à l'origine d'une personne originaire de l'Afrique du Nord et pouvant nuire à son intégration, se fait sentir au début de l'établissement. «Mais après trois ans, les études montrent que ce n'est plus significatif. Si c'était de la discrimination, ce coefficient serait toujours significatif. L'employeur s'adapte et apprend à décoder ce que vaut un diplôme du Maghreb», a-t-il expliqué.
Et si le Québec fait moins bien que l'Ontario et la Colombie-Britannique, c'est qu'il n'est pas aussi habitué qu'eux à accueillir des immigrants, estime Jean Renaud. «Le Québec n'a que 30 ans de pratique avec l'immigration. Ça date de la loi 101. Avant ça, l'immigration était plutôt gérée par le côté anglophone du Québec, a-t-il soutenu. Mais on est encore en train de se chicaner sur le foulard. C'est comme si on confirmait le fait que c'est normal de discriminer. L'employeur envoie le message que ce ne sont pas des gens comme nous, qu'ils sont marginaux. Ça n'aide pas à rehausser le taux d'emploi.»
Professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Sylvie Gravel ne croit pas qu'il est exact de parler de discrimination de la part des employeurs. «Les grandes entreprises ont fait beaucoup d'effort pour redresser la situation et éliminer toutes les étapes qui portent préjudice aux immigrants», assure-t-elle. Elle remarque qu'un grand nombre de petites entreprises ont recours à des immigrants. Certains employeurs du secteur agricole vont même se mettre à parler espagnol pour mieux communiquer avec leurs employés latino-américains. «Le vrai problème, c'est d'intégrer les immigrants dans un emploi qui correspond à leur diplôme. On est en pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs pour lesquels on n'a pas nécessairement sollicité des immigrants», rappelle Mme Gravel, en précisant que c'est en train de changer.
La faute de la grille... et de la langue
La grille n'est donc pas si adéquate que ça. Jean Renaud, qui s'est intéressé aux variables permettant d'améliorer les prédictions d'accès à l'emploi pour un nouvel arrivant, a constaté que la grille de sélection ne comptait que pour 13 % dans ce savant calcul. «On a essayé de voir combien de temps ça prend à un immigrant pour avoir un emploi qualifié et quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer ça. La grille ne compte pas pour beaucoup», note-t-il. Selon lui, cette grille utilisée par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles n'est pas nécessairement conçue pour d'abord sélectionner de bons ouvriers appariés aux emplois disponibles. «Elle a avant tout comme but de nous choisir des concitoyens, des gens avec qui on va vivre. Des concitoyens qui deviendront nos amis, nos voisins, des gens qui vont tomber amoureux avec nos enfants.»
Certes, des problèmes plus structurels liés aux blocages que peuvent engendrer certains ordres professionnels dans le cas des professions règlementées sont désormais connus. L'attention a été moins portée sur les problèmes d'intégration sur le marché du travail causés par l'obligation, dans certains cas, de parler le français et l'anglais. «Il existe des exigences de bilinguisme pour un certain niveau d'emploi», note François Rebello. «Le fait de ne pas parler anglais est souvent un frein plus grand à l'emploi que le fait de ne pas parler français», ajoute-t-il, constatant que cette réalité bien québécoise nuit à certains membres de la communauté maghrébine, par exemple, qui connaissent souvent mieux le français que l'anglais.
Les études de Jean Renaud ne lui ont pourtant pas permis de conclure que le facteur de la langue était significatif. «La connaissance de l'anglais et du français n'est pas un facteur qui augmente l'accès au marché du travail. C'est plutôt une question de réseau au sens très large.»
Marie-Thérèse Chicha abonde. «Il ressort que la majorité des entreprises québécoises ont recours aux réseaux de connaissances pour leur recrutement. Et même quand ils sont diplômés du Québec, [les immigrants] n'arrivent pas nécessairement à se créer un réseau de connaissances susceptible de les aider à trouver un emploi. Ils n'ont pas un bon réseau culturel pour les informer informellement. Souvent, leur réseau est constitué de gens d'Emploi Québec ou des universités, qui ne les orientent pas nécessairement vers des emplois qui sont porteurs», fait-elle remarquer.
Pour sa part, Sylvie Gravel insiste sur l'importance de laisser le temps aux immigrants de bien apprivoiser leur milieu de travail. «Il faut comprendre la difficulté [pour les immigrants] de passer l'étape de la probation. On va reprocher à des gens de ne pas bien fonctionner dans le milieu, de ne pas être sociables parce qu'ils ne vont pas prendre une bière après le travail ou parce qu'ils ne jouent pas aux hockey avec les employés. Mais on oublie qu'il y a un élément qui s'appelle s'insérer dans une culture organisationnelle et une dynamique de socialisation», conclut-elle en appelant à plus d'indulgence.
Comme quoi il ne suffit pas d'avoir la tête de l'emploi. Encore faut-il s'assurer de la viabilité du «vivre ensemble».
Immigrants qualifiés cherchent emploi
Champion pour attirer une main-d'oeuvre compétente, le Québec parvient difficilement à les intégrer au marché du travail
Le Québec est champion pour attirer une main-d'oeuvre immigrante qualifiée, mais devient grand perdant lorsqu'il s'agit de les intégrer au marché du travail. C'est ce que permet de conclure une étude publiée par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), qui a compilé des données statistiques notamment sur le taux d'emploi, la langue parlée des immigrants, leur âge et leur pays d'origine pour les comparer avec celles des Canadiens nés au Canada dans trois provinces à haut taux d'immigration comme le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario.
En 2006, le taux d'emploi des immigrants au Québec était inférieur par 11,4 points à celui des Québécois natifs, soit un écart deux fois plus grand que celui observé dans les deux autres provinces, soit l'Ontario (5 points) et la Colombie-Britannique (5,1). Et ce, même si la part d'immigration totale est beaucoup plus grande dans ces deux provinces qu'au Québec.
Les auteurs de l'étude Immigration au Québec: politiques et intégration au marché du travail, s'attendaient à ce que le Québec présente effectivement un plus grand écart du taux d'emploi entre les immigrants et les Québécois nés dans la province que ses deux rivales. Ils ont aussi observé que les Québécois natifs de la province ont un taux d'emploi élevé (82,6 %) qui est très semblable à celui des Ontariens et des Britannico-Colombiens. «Alors, on pourrait d'abord penser que cette grande différence du taux d'emploi [entre les immigrants et les non-immigrants] au Québec est attribuable à une moins bonne performance d'intégration des immigrants sur le marché du travail», a analysé Maude Boulet, doctorante en relations industrielles à l'Université de Montréal et coauteure de l'étude avec son directeur, Brahim Boudarbat.
Pourtant, les immigrants du Québec sont parmi les plus qualifiés et leur niveau de scolarisation a même crû de façon phénoménale en 25 ans, constatent les chercheurs dans leur étude. La proportion des immigrants récents du Québec (âgés de 25 ans et plus) qui détiennent au moins un baccalauréat est passée de 15,4 % en 1981 à 51 % en 2006.
Et non seulement les nouveaux arrivants du Québec sont-ils les moins nombreux à ne pas connaître les deux langues officielles du pays, mais ils sont également très nombreux à maîtriser le français, soit 60,4 % des immigrants admis au Québec en 2008. Enfin, les immigrants du Québec font aussi de plus en plus partie de la tranche la plus active sur le marché du travail.
Tetchena Bellange a constaté ce paradoxe en réalisant son court-métrage documentaire Médecins sans résidence, sur les difficultés qu'éprouvent les médecins diplômés à l'étranger à se trouver un emploi au Québec. «J'ai rencontré beaucoup de gens déçus. Ils parlent parfaitement français et viennent en attendant un an, deux ans, trois ans et n'arrivent pas à travailler», a dit la jeune femme, dont le film est disponible depuis hier sur le site de l'ONF. «J'avais en tête le cliché du médecin devenu chauffeur de taxi, mais j'ai vu qu'il y avait des médecins dont on reconnaissait les équivalences, mais pour qui ça bloquait encore.»
L'intégration... pire au Québec
Selon l'étude, une bonne intégration des immigrants sur le marché du travail dépend beaucoup de leur région d'origine, du lieu d'obtention de leur diplôme et de leur âge à l'arrivée au Canada. Ainsi, les chercheurs ont remarqué que ce sont les immigrants originaires de l'Afrique du Nord (Maghreb) et du Moyen-Orient qui ont le plus de mal à intégrer le marché du travail au Québec. Dans les deux autres provinces de l'étude, qui s'en tirent mieux sur le plan de l'intégration, les immigrants viennent majoritairement d'Asie. «Effectivement, au Québec [...] on remarque que ce sont les immigrants venant de l'Afrique du Nord qui s'intègrent le moins bien au marché du travail, avec un taux de chômage de 19 %», a dit Mme Boulet en marchant sur des oeufs. «Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas accepter d'immigrants d'Afrique du Nord ou dire que c'est leur faute. Mais on peut avancer le fait que ces immigrants subissent plus de discrimination à l'emploi», a-t-elle précisé.
L'étude révèle également que c'est au Québec que le lieu d'obtention du diplôme pénalise le plus les immigrants. Ceux qui avaient acquis un diplôme à l'étranger accusaient un recul de 18,9 points de pourcentage de leur taux d'emploi par rapport aux natifs, comparativement à 8,6 points en Ontario et 10,2 points en Colombie-Britannique. Et même s'ils obtiennent un diplôme canadien, les immigrants du Québec sont encore les plus désavantagés sur le marché de l'emploi par rapport aux Québécois natifs.
Mme Boulet fait remarquer que l'étude a des limites économétriques, car elle n'a pas tenu compte du taux de scolarisation des immigrants dans chaque province, par exemple. Elle doute toutefois que cette variable ait une influence sur le faible taux d'emploi des immigrants au Québec puisque leur taux de scolarité est plutôt élevé.
Par ailleurs, la doctorante souligne la pertinence d'avoir comparé les trois provinces. «Le Québec est la seule province qui ait une grille de sélection d'immigrants, avec ses propres critères, différents de ceux du fédéral que suivent les autres provinces canadiennes», a fait remarquer Mme Boulet. C'est signe que la grille fonctionne et que le gouvernement a un réel pouvoir puisqu'il réussit à attirer des immigrants selon ses critères. À lui de voir comment il peut mener à bien leur intégration, suggère-t-elle.

En 2006, le taux d'emploi des immigrants au Québec était inférieur par 11,4 points à celui des Québécois natifs, soit un écart deux fois plus grand que celui observé dans les deux autres provinces, soit l'Ontario (5 points) et la Colombie-Britannique (5,1). Et ce, même si la part d'immigration totale est beaucoup plus grande dans ces deux provinces qu'au Québec.
Les auteurs de l'étude Immigration au Québec: politiques et intégration au marché du travail, s'attendaient à ce que le Québec présente effectivement un plus grand écart du taux d'emploi entre les immigrants et les Québécois nés dans la province que ses deux rivales. Ils ont aussi observé que les Québécois natifs de la province ont un taux d'emploi élevé (82,6 %) qui est très semblable à celui des Ontariens et des Britannico-Colombiens. «Alors, on pourrait d'abord penser que cette grande différence du taux d'emploi [entre les immigrants et les non-immigrants] au Québec est attribuable à une moins bonne performance d'intégration des immigrants sur le marché du travail», a analysé Maude Boulet, doctorante en relations industrielles à l'Université de Montréal et coauteure de l'étude avec son directeur, Brahim Boudarbat.
Pourtant, les immigrants du Québec sont parmi les plus qualifiés et leur niveau de scolarisation a même crû de façon phénoménale en 25 ans, constatent les chercheurs dans leur étude. La proportion des immigrants récents du Québec (âgés de 25 ans et plus) qui détiennent au moins un baccalauréat est passée de 15,4 % en 1981 à 51 % en 2006.
Et non seulement les nouveaux arrivants du Québec sont-ils les moins nombreux à ne pas connaître les deux langues officielles du pays, mais ils sont également très nombreux à maîtriser le français, soit 60,4 % des immigrants admis au Québec en 2008. Enfin, les immigrants du Québec font aussi de plus en plus partie de la tranche la plus active sur le marché du travail.
Tetchena Bellange a constaté ce paradoxe en réalisant son court-métrage documentaire Médecins sans résidence, sur les difficultés qu'éprouvent les médecins diplômés à l'étranger à se trouver un emploi au Québec. «J'ai rencontré beaucoup de gens déçus. Ils parlent parfaitement français et viennent en attendant un an, deux ans, trois ans et n'arrivent pas à travailler», a dit la jeune femme, dont le film est disponible depuis hier sur le site de l'ONF. «J'avais en tête le cliché du médecin devenu chauffeur de taxi, mais j'ai vu qu'il y avait des médecins dont on reconnaissait les équivalences, mais pour qui ça bloquait encore.»
L'intégration... pire au Québec
Selon l'étude, une bonne intégration des immigrants sur le marché du travail dépend beaucoup de leur région d'origine, du lieu d'obtention de leur diplôme et de leur âge à l'arrivée au Canada. Ainsi, les chercheurs ont remarqué que ce sont les immigrants originaires de l'Afrique du Nord (Maghreb) et du Moyen-Orient qui ont le plus de mal à intégrer le marché du travail au Québec. Dans les deux autres provinces de l'étude, qui s'en tirent mieux sur le plan de l'intégration, les immigrants viennent majoritairement d'Asie. «Effectivement, au Québec [...] on remarque que ce sont les immigrants venant de l'Afrique du Nord qui s'intègrent le moins bien au marché du travail, avec un taux de chômage de 19 %», a dit Mme Boulet en marchant sur des oeufs. «Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas accepter d'immigrants d'Afrique du Nord ou dire que c'est leur faute. Mais on peut avancer le fait que ces immigrants subissent plus de discrimination à l'emploi», a-t-elle précisé.
L'étude révèle également que c'est au Québec que le lieu d'obtention du diplôme pénalise le plus les immigrants. Ceux qui avaient acquis un diplôme à l'étranger accusaient un recul de 18,9 points de pourcentage de leur taux d'emploi par rapport aux natifs, comparativement à 8,6 points en Ontario et 10,2 points en Colombie-Britannique. Et même s'ils obtiennent un diplôme canadien, les immigrants du Québec sont encore les plus désavantagés sur le marché de l'emploi par rapport aux Québécois natifs.
Mme Boulet fait remarquer que l'étude a des limites économétriques, car elle n'a pas tenu compte du taux de scolarisation des immigrants dans chaque province, par exemple. Elle doute toutefois que cette variable ait une influence sur le faible taux d'emploi des immigrants au Québec puisque leur taux de scolarité est plutôt élevé.
Par ailleurs, la doctorante souligne la pertinence d'avoir comparé les trois provinces. «Le Québec est la seule province qui ait une grille de sélection d'immigrants, avec ses propres critères, différents de ceux du fédéral que suivent les autres provinces canadiennes», a fait remarquer Mme Boulet. C'est signe que la grille fonctionne et que le gouvernement a un réel pouvoir puisqu'il réussit à attirer des immigrants selon ses critères. À lui de voir comment il peut mener à bien leur intégration, suggère-t-elle.
Le salut du régime de pensions passe par l'immigration
Selon le Conference Board, le Canada devra accueillir 100 000 immigrants de plus par année
La Presse canadienne 14 avril 2010

Photo : Agence Reuters Blair Gable
Le ministre des Finances, Jim Flaherty, a lancé des consultations pour réformer le régime de pensions.
Toronto — Le Canada devra accueillir environ 100 000 immigrants de plus par année pour accroître la productivité et aider à payer pour le régime de pensions, a estimé hier l'économiste en chef du Conference Board du Canada.
Le gouvernement devra mette en branle une politique d'immigration très active pour assurer la croissance de la main-d'oeuvre, accroître le nombre de travailleurs qui contribuent au régime de pensions et contrebalancer les effets de l'exode des baby-boomers du marché du travail, a affirmé Glen Hodgson à l'occasion d'un sommet sur l'avenir des pensions organisé par le Conference Board. Avec le ralentissement de la croissance du marché du travail qui s'annonce pour les prochaines décennies, un moins grand nombre de travailleurs contribueront au régime de retraite, alors même que les retraités seront plus nombreux à en tirer des prestations.
Les gouvernements et entreprises à travers le monde tentent de désamorcer la potentielle crise qui s'annonce avec le vieillissement rapide d'une génération de travailleurs qui n'ont pas mis assez d'argent de côté pour leur retraite.
Comme la population vieillit et les familles comptent moins d'enfants, les immigrants — qui arrivent actuellement au pays au rythme d'environ 250 000 par année — deviendront la seule source de croissance de la population canadienne aux environs de 2030, a estimé M. Hodgson. Même si une forte immigration ne renversera pas à elle seule le vieillissement du Canada, elle aidera à stabiliser la croissance à environ 1 % par année.
Alberta
Dans la foulée, le ministre des Finances de l'Alberta a indiqué hier qu'il n'a aucune intention de collaborer à une augmentation du capital du Régime de pensions du Canada (RPC). Ted Morton a lancé un avertissement sans équivoque, en déclarant que sa province privilégie une approche «graduelle».
Plutôt que d'engraisser le RPC d'une manière qui ne profiterait peut-être même pas à ceux dont la santé financière est fragile, l'Alberta préfèrerait que les gouvernements y aillent de quelques changements règlementaires pour permettre aux institutions financières d'inciter les épargnants à économiser en vue de leurs vieux jours, a expliqué le ministre Morton. On devrait donner aux institutions financières 10 ans pour démontrer ce qu'elles peuvent faire, a-t-il ajouté, avant une intervention gouvernementale plus musclée.
Lors d'un discours à Calgary, hier, M. Morton a déclaré que le RPC impose aux jeunes le fardeau financier découlant de la proportion croissante de la population qui part à la retraite.
M. Morton a toutefois précisé que sa position contre un RPC plus ample n'est pas encore la position officielle de sa province, puisque des consultations publiques ont toujours lieu. Il dit toutefois que l'idée de voir le secteur privé bonifier les régimes de retraite semble recueillir de plus en plus d'appuis à travers le pays.
Lors d'un discours lundi soir, le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, avait incité à la prudence, estimant que les régimes de retraite du pays ne sont pas encore en état de crise. L'Alberta et le gouvernement fédéral semblent donc être sur la même longueur d'ondes dans ce dossier.
Le gouvernement devra mette en branle une politique d'immigration très active pour assurer la croissance de la main-d'oeuvre, accroître le nombre de travailleurs qui contribuent au régime de pensions et contrebalancer les effets de l'exode des baby-boomers du marché du travail, a affirmé Glen Hodgson à l'occasion d'un sommet sur l'avenir des pensions organisé par le Conference Board. Avec le ralentissement de la croissance du marché du travail qui s'annonce pour les prochaines décennies, un moins grand nombre de travailleurs contribueront au régime de retraite, alors même que les retraités seront plus nombreux à en tirer des prestations.
Les gouvernements et entreprises à travers le monde tentent de désamorcer la potentielle crise qui s'annonce avec le vieillissement rapide d'une génération de travailleurs qui n'ont pas mis assez d'argent de côté pour leur retraite.
Comme la population vieillit et les familles comptent moins d'enfants, les immigrants — qui arrivent actuellement au pays au rythme d'environ 250 000 par année — deviendront la seule source de croissance de la population canadienne aux environs de 2030, a estimé M. Hodgson. Même si une forte immigration ne renversera pas à elle seule le vieillissement du Canada, elle aidera à stabiliser la croissance à environ 1 % par année.
Alberta
Dans la foulée, le ministre des Finances de l'Alberta a indiqué hier qu'il n'a aucune intention de collaborer à une augmentation du capital du Régime de pensions du Canada (RPC). Ted Morton a lancé un avertissement sans équivoque, en déclarant que sa province privilégie une approche «graduelle».
Plutôt que d'engraisser le RPC d'une manière qui ne profiterait peut-être même pas à ceux dont la santé financière est fragile, l'Alberta préfèrerait que les gouvernements y aillent de quelques changements règlementaires pour permettre aux institutions financières d'inciter les épargnants à économiser en vue de leurs vieux jours, a expliqué le ministre Morton. On devrait donner aux institutions financières 10 ans pour démontrer ce qu'elles peuvent faire, a-t-il ajouté, avant une intervention gouvernementale plus musclée.
Lors d'un discours à Calgary, hier, M. Morton a déclaré que le RPC impose aux jeunes le fardeau financier découlant de la proportion croissante de la population qui part à la retraite.
M. Morton a toutefois précisé que sa position contre un RPC plus ample n'est pas encore la position officielle de sa province, puisque des consultations publiques ont toujours lieu. Il dit toutefois que l'idée de voir le secteur privé bonifier les régimes de retraite semble recueillir de plus en plus d'appuis à travers le pays.
Lors d'un discours lundi soir, le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, avait incité à la prudence, estimant que les régimes de retraite du pays ne sont pas encore en état de crise. L'Alberta et le gouvernement fédéral semblent donc être sur la même longueur d'ondes dans ce dossier.